Du cinéma bio, c’est-à-dire biographique, en voulez-vous? En v’là. D’ici la fin de 2014, pas moins de neuf films faisant le portrait de personnalités ayant marqué à leur façon leur époque prendront l’affiche : Selma, Unbroken, Wild, Grace de Monaco, Foxcatcher, The Imitation Game, Big Eyes, Mr. Turner, D’où je viens. Parmi ceux-ci, D’où je viens se démarque par sa teneur documentaire et aussi parce qu’il ne fait pas le portrait d’un seul homme ou d’une seule femme ni d’un événement en particulier, mais bien le portrait d’un quartier en entier, Verdun.
Durant les Fêtes, alors que la population en général sera tentée d’aller voir un long métrage américain aux visées oscarisables, on peut se demander pourquoi l’ONF a choisi de lancer un tel documentaire durant cette période. En entrevue, le réalisateur du film, Claude 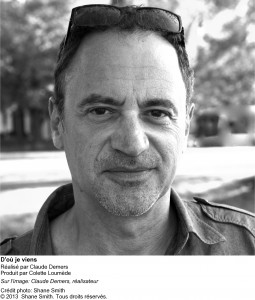 Demers (Les Dames en bleu), avoue s’être aussi posé la question. « Au départ j’étais craintif, puis, j’ai endossé la stratégie du distributeur qui y voit l’occasion d’offrir un film différent pour tous ceux qui ne veulent pas aller voir un blockbuster américain. Mais ça fait peur, évidemment, et on travaille auprès de certains réseaux communautaires afin de rejoindre le plus de public possible ».
Demers (Les Dames en bleu), avoue s’être aussi posé la question. « Au départ j’étais craintif, puis, j’ai endossé la stratégie du distributeur qui y voit l’occasion d’offrir un film différent pour tous ceux qui ne veulent pas aller voir un blockbuster américain. Mais ça fait peur, évidemment, et on travaille auprès de certains réseaux communautaires afin de rejoindre le plus de public possible ».
D’où je viens est une œuvre très onirique, filmée magnifiquement, aux images superbes portées par une musique éthérée ou classique donnant un ton très personnel à l’ensemble. Si le cinéaste a fait de Verdun son point d’ancrage, c’est parce que c’est le quartier de son enfance, mais aussi, un territoire méconnu des Montréalais pourtant situé à quinze minutes à peine du centre-ville en voiture. Une île dans une île, dira-t-il, un lieu tapissé de tours à logements, mais aussi bordé par le fleuve où certains y pêchent régulièrement. « Je parle d’un quartier en bordure de Montréal, oui, mais d’un quartier qui pourrait être le vôtre, qui pourrait être n’importe où, un endroit qui ressemble à d’autres et en plus personne ne sait qu’en en dix minutes de bateau, on peut y chasser le canard en ayant une vue sur Montréal. Je me suis pris un appartement à Verdun durant deux mois et demi, en plein hiver. Je voulais me lever le matin et me replonger dans ma vie d’adolescent à Verdun et mieux savoir comment aborder mon sujet alors que je voulais toucher à l’enfance. »
Au fil de l’écriture, cinq thèmes se sont imposés à Claude Demers qui a donc tricoté son film autour de cinq mailles : l’enfance, la résistance, le territoire, le langage, la foi. Cinq thèmes nourris par une série de scènes évocatrices, tirées du quotidien de Verdun, et qui font parfois penser aux tableaux du peintre Edward Hopper. L’une de ces scènes, marquante, a été tournée dans un Dunkin Donuts (l’un des rares encore ouverts au Québec), filmée de l’extérieur en un plan-séquence qui ne triche pas, un plan simple et  très révélateur de la vie de quartier. Cette séquence qui pourrait paraître banale, démontre à quel point Claude Demers ne voulait pas construire une œuvre de façon traditionnelle et tenait à sortir de sa zone de confort. « Mon film, on le qualifie d’ovni et c’est tant mieux. Je trouve souvent que tous les longs métrages se ressemblent. Moi, j’aime qu’une œuvre nous dépasse. On retrouve encore ça en littérature, mais au cinéma, ça devient rare. J’aime être dérouté, j’aime qu’on m’amène en voyage. Donc, j’ai fait un film lyrique. Mon film est une quête de soi tout en se déployant d’une façon universelle, sans rester narcissique ». D’où je viens, en salle le 26 décembre prochain.
très révélateur de la vie de quartier. Cette séquence qui pourrait paraître banale, démontre à quel point Claude Demers ne voulait pas construire une œuvre de façon traditionnelle et tenait à sortir de sa zone de confort. « Mon film, on le qualifie d’ovni et c’est tant mieux. Je trouve souvent que tous les longs métrages se ressemblent. Moi, j’aime qu’une œuvre nous dépasse. On retrouve encore ça en littérature, mais au cinéma, ça devient rare. J’aime être dérouté, j’aime qu’on m’amène en voyage. Donc, j’ai fait un film lyrique. Mon film est une quête de soi tout en se déployant d’une façon universelle, sans rester narcissique ». D’où je viens, en salle le 26 décembre prochain.

